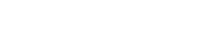Il correspond à l'émission d'électrons par un matériau soumis à l'action de la lumière. Il a été interprété par H. R. HERTZ* en 1887. Cet effet ne peut pas être expliqué lorsque l'on considère que la lumière est une onde : Pour une cathode de césium, une lumière de longueur d'onde supérieure à 650 nm ne produit aucun effet quelque soit son intensité.
En 1905 A. EINSTEIN* introduit la notion de quantum d'énergie (ou photon). Une lumière de fréquence ν est constituée de grains d'énergie h.ν ( h = constante de Planck, introduite par celui-ci lors de son étude du corps noir).
Dans cette interprétation, l'absorption d'un photon, permet d'expliquer toutes les caractéristiques du phénomène. Les photons de la source lumineuse possèdent une énergie caractéristique h.ν. Lorsqu'un électron du matériau absorbe un photon et que son énergie est supérieure à l'énergie W de liaison de l'électron, celui-ci est éjecté; sinon il ne peut pas s'échapper du matériau. L'augmentation de l'intensité de la source lumineuse ne change pas l'énergie des photons mais seulement leur nombre.
Si l'énergie de l'électron éjecté est e.U alors : e.U = h.ν − W (1)
Mesure de la constante de Planck :
La mesure de U(ν) permet de déterminer la valeur de h et de W en utilisant la relation (1) pour plusieurs valeurs de la fréquence. L'application d'une tension négative V sur l'anode annule le courant photoélectrique quand V = U. L'appréciation de la nullité du courant photoélectrique, qui toujours très faible, est difficile. On préfère utiliser maintenant la méthode du condensateur.
Celui-ci est branché entre l'anode et la cathode. Il se charge avec le courant anodique et produit de ce fait une tension inverse V. Quand celle-ci atteint U, la charge s'arrête.
Comme les courants sont très faibles, il faut utiliser un condensateur à faibles fuites et mesurer V avec un montage suiveur à très grande impédance d'entrée.
Comme source lumineuse, on peut utiliser une lampe à vapeur de mercure. Les raies sont sélectionnées avec un monochromateur (prisme à vision directe) ou plus simplement avec un jeu de filtres interférentiels et on concentre le faisceau sur la cathode avec une lentille.
Pour réaliser cette manipulation, on doit utiliser des cellules conçues spécialement. Le césium permet d'obtenir un courant assez intense mais il a tendance à migrer sur le fil d'anode quand la cellule est soumise à de forts éclairements. Si le faisceau éclaire une anode couverte de césium, les mesures sont totalement erronées. Il faut concentrer le faisceau sur la cathode et protéger la cellule des lumières intenses. Il existe des cellules dont l'anode est constituée par une boucle que l'on peut chauffer avec un courant intense ce qui permet de faire retourner le césium sur la cathode.
Applications de l'effet photoélectrique :
Effet photoélectrique externe : Utilisé dans les cellules et les photo-multiplicateurs pour la mesure des intensités lumineuses.
Effet photoélectrique interne dans les semi-conducteurs : Il résulte de l'excitation d'un électron dans la bande de conduction qui donne en général lieu à un courant. Utilisé dans des détecteurs (photodiodes, phototransistor, C.D.C ...) ou pour fournir de l'électricité (cellule photo-voltaïque).
Utilisation :
Choisir la nature de la cathode avec les cases à cocher.
Choisir la longueur d'onde de la lumière avec la liste de choix.
Le bouton [Mesure] permet de lancer l'animation. Quand la mesure est terminée, le point correspondant est affiché sur le graphe par une croix.
Le bouton [RàZ] permet d'effacer les croix des mesures antérieures.
En cochant la case [Courbe] on trace la courbe V = f (ν);
Dans la réalité, la durée de la charge du condensateur est fonction de l'intensité lumineuse.
A partir des mesures, déterminer la valeur de la constante de Planck et les valeurs du travail d'extraction pour les deux cathodes utilisées.
Attention aux unités !!! ( e =1,610-19 C , c = 3.108 m/s)
En cliquant sur un bouton de la souris, on fait apparaître une mire sur le graphique.
 Cellule photoélectrique au césium.
Cellule photoélectrique au césium.
Le fil d'anode forme une boucle dont les extrémités sont reliées aux bornes du culot à vis.
La cathode est reliée à l'électrode située à gauche de la photographie.
La température de fusion du césium est 28,3 °C.