

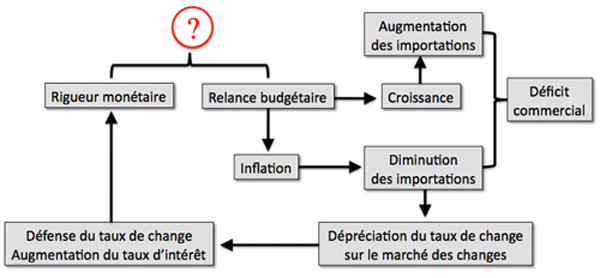 En économie ouverte une augmentation du déficit budgétaire engendrant une augmentation du revenu et de la production a trois effets indésirables qui viennent réduire l'avantage procuré.
En économie ouverte une augmentation du déficit budgétaire engendrant une augmentation du revenu et de la production a trois effets indésirables qui viennent réduire l'avantage procuré.
Illustration pour la relance mise en œuvre par le premier gouvernement de gauche du premier mandat de François Mitterand (1981).
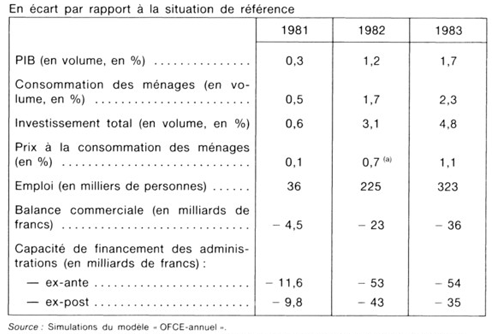 La relance est budgétaire (accroissement des prestations sociales , relance de l’investissement public , augmentation des salaires et embauche de fonctionnaires) et s'accompagne de mesure législatives (augmentation du SMIC compensée pour les entreprises par un allégement des charges que l’Etat prend à son compte) .
La relance est budgétaire (accroissement des prestations sociales , relance de l’investissement public , augmentation des salaires et embauche de fonctionnaires) et s'accompagne de mesure législatives (augmentation du SMIC compensée pour les entreprises par un allégement des charges que l’Etat prend à son compte) .
L’effet de la relance a été relativement limité en raison du décalage conjoncturel et de politique économique existant entre la France et ses concurrents. Au moment où la France relance, ses partenaires, e particulier l'Allemagne, dans le sillage des gouvernements anglais (Mme Thatcher) et américain (Ronald Reagan) appliquent des politiques de rigueur qui ont pour effet de plonger l’économie mondiale dans la dépression .
Le taux de croissance de l’économie française devient donc, en 81et 82, supérieur au taux de croissance de ses concurrents. L’effet sur le solde de la balance commerciale va se faire sentir très rapidement : le déficit commercial se creuse. La Banque de France défend la valeur du franc mais très vite le gouvernement prend acte des tensions sur le taux de change et décide de dévaluer par trois fois d'octobre 1981 à mars 1983.
Le tableau montre l'écart entre les performances observées (la réalité) et ce qui serait advenu en l'absence de relance(estimation de l'Observatoire français de conjoncture économique). Il faut donc porter un jugement nuancé car si l'inflation a augmenté (assez faiblement) et si le déficit commercial a été creusé ce n'est pas de 100 milliards comme on le lit souvent, les 100 milliards de déficit de 1983 correspondent à 64 milliards qui auraient existé en tout état de cause. En revanche il y a bien eu une amélioration de l'emploi et une plus forte croissance.
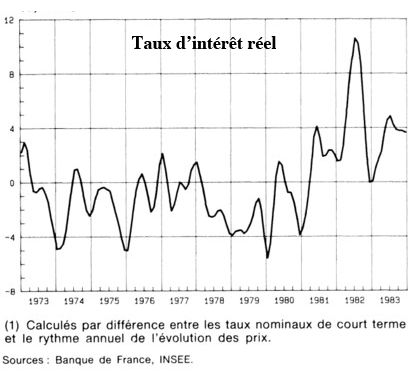 L'obligation de défendre le franc dans le cadre du SME et cela malgré 3 dévaluations à pousser les taux d'intérêt réel à des niveau très élevés ce qui a bien entendu freiné les effets positifs de la relance.
L'obligation de défendre le franc dans le cadre du SME et cela malgré 3 dévaluations à pousser les taux d'intérêt réel à des niveau très élevés ce qui a bien entendu freiné les effets positifs de la relance.
Ainsi dès 1983, le choix entre la poursuite d'une politique de soutien de la demande impliquant une sortie du SME (système monétaire européen) puisqu'il faut régulièrement dévaluer pour rétablir la compétitivité prix. C'est une troisième solution qui sera retenue : la désinflation compétitive. Pour rester dans le SME, défendre la stabilité du taux de change, faire du franc une monnaie aussi forte que le mark allemand, il faut rapprocher le taux d'inflation de la France de celui de l'Allemagne.
La lutte contre l'inflation prend la forme d'une politique de rigueur budgétaire combinée à des mesures structurelles pour modifier la liaison entre prix et salaires, en particulier par l'abandon de l'indexation de la variation des salaires sur la variation anticipée des prix.
Tous les goouvernements qui se sont succédés depuis le virage de 1983 ont maintenu cette orientation jusqu'à l'entrée dans la zone euro en 2000. La disparition de la contrainte du taux de change - forme visible de la contrainte extérieure - pouvait redonner des degrés de liberté à la politique budgétaire, mais le PSC (pacte de stabilité et de croissance) vient borner cette liberté (le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB.