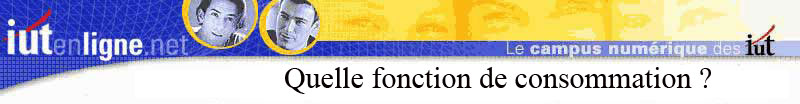
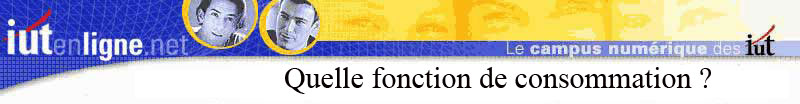
Dans l'analyse keynésienne de la consommation le principal facteur objectif de la dépense de consommation est le revenu.
En plus de ce déterminant objectif, Keynes énumère huit facteurs subjectifs
: « précaution, prévoyance, calcul, ambition, indépendance, initiative,
orgueil et avarice » en montrant qu'ils jouent un rôle non essentiel..
Il montre aussi que le taux d'intérêt est un déterminant de la
consommation mais de manière très faible. La hausse du taux d'intérêt
provoque une baisse du prix des obligations (quand le taux d'intérêt
monte, la valeur des obligations baisse - c'est l'effet balançoire) et
ainsi de la richesse des agents détenant des obligations. Pour rétablir
cette richesse les ménages réduisent leur consommation. La consommation
est ici, comme chez Irving Fisher, une fonction décroissante du taux d'intérêt, mais cet effet richesse :
- est marginal selon Keynes ;
- et il ne peut pas être interprété comme un arbitrage entre
consommation et épargne (ce n'est pas un effet de substitution, c'est
uniquement un effet revenu).
La fonction keynésienne sous sa forme linéaire C = cY + C0
a été testée de deux manières : sur des séries temporelles à partir des
données des comptes nationaux et sur des coupes instantanées.
- Dans le cas des séries temporelles
on cherche la corélation entre le revenu et la consommation pour des
années successives. Si la relation est vérifiée à court terme par
exemple de 1965 à 1974 la liaison est vérifiée et la propension
marginale à consommer est estimée à 0,82, elle ne l'est pas à long
terme puisque par exemple pour les Etats-Unis de 1896 à 1938 (Simon
Kuznets) la relation est plutôt C = cY avec une propension marginale à consommer valant 0,86.
- Pour les séries en coupe intantanées
on cherche la relation entre revenu et consommation pour des catégories
de revenus différentes, des riches vers les pauvres, pour une même
année. Ces séries montrent que la fonction keynésienne est confirmée.
Mais la propension marginale µa consommer ébvaluée en coupe instantanée
est inférieure à celle obtenue à partir de séries temporelles.
La consommation serait moins sensible, à court terme, aux variations du revenu qu'elle ne l'est à long terme.
Le schéma suivant présente de manière synthétique ey incomplête les tentatives de dépassement de la fonction keynésienne élémentaire. ces critiques de la théorie keynésienne de la consommation.
| Les théories du revenu relatif | dans l'espace | Adaptation à la norme de consommation (D.S. Brady et R.D. Friedman, 1947) | ||
| Les effets « bandwagon » (prendre le train en marche) et de snobisme dans l’espace (Harvey Liebenstein, 1950) | ||||
| Les effets d’imitation et de démonstration (James Duesenberry, 1947-1948) | ||||
| dans le temps | L’effet-mémoire (Thomas Brown, 1952) | |||
| L’effet-cliquet (J.S. Duesenberry) | ||||
| Effet de formation d’habitudes et effet-parc | ||||
| La consommation est fonction de la répartition des revenus | ||||
| La consommation est fonction de l’évolution des variables monétaires et financières, en particulier l’inflation (effet d’encaisses réelles) et le taux d’intérêt (influence sur le prix des actifs réels et par conséquent sur la richesse) | ||||
| La théorie du revenu permanent de Milton Friedman (1957) | ||||
| La théorie du cycle de vie d’Alberto Ando et Franco Modigliani (1963) | ||||
Les théories du revenu relatif permettent d'introduire deux idées simples :
- les ménages définissent leur niveau et structure de consommation non
pas uniquement par rapport à leurs revenus (personnels) mais également
en se référant aux dépenses, et donc aux revenus, de la classe sociale
immédiatement supérieure
- les ménages ont tendance à vouloir maintenir leur niveau de
consommation par rapport à celui des périodes précédentes, ainsi la
consommation d’une période est plus fonction du revenu antérieur le
plus élevé que du revenu de la période courante.
Lorsque le revenu baisse en période de récession ou augmente en période
de reprise, la consommation ne varie pas proportionnellement. L’effet
Cliquet empêche la consommation de baisser (ce qui se traduit par une
baisse de l’épargne) et freine son augmentation (ce qui permet de
reconstituer l’épargne).
Avec la théorie du revenu permanent
Milton Friedman veut invalider le principe de la stabilité de la
relation consommation / revenu. Pour cela il faut distinguer dans le
revenu des ménages un "revenu permanent" et une part temporaire ou
accidentelle dite "revenu transitoire" (des plus-values, des heures
supplémentaires, les aléas de l'activité pour les travailleurs
indépendants…)
Friedman observe que le revenu réel n'est jamais
régulier et que la consommation des ménages est plus stable dans le
temps que ce dernier. Une baisse de revenu ne correspond pas toujours à
une baisse de consommation parce que la consommation n'est pas
seulement fonction du revenu courant, mais des revenus (revenus passés
et revenus futurs c'est-à-dire la richesse de l'agent). Donc, les
agents ne déterminent pas leur consommation courante en fonction du
revenu courant mais plutôt du "revenu permanent", qu'il définit comme
étant le revenu qu’un consommateur peut dédier à sa consommation en
maintenant constante la valeur de son capital. Autrement dit, le revenu
permanent est le revenu moyen qu'il pense percevoir pendant toute sa
vie, déterminé par la richesse totale anticipée et le taux d'intérêt.
Le revenu transitoire sera totalement épargné s'il est positif, financé
par emprunt s'il est négatif. Une variation du revenu n'affectera la
consommation que si elle modifie le revenu permanent.
La théorie du cycle de vie
proposée par Alberto Ando et Franco Modigliani repose sur une approche
microéconomique (l’analyse du comportement rationnel d’un agent qui
cherche à maximiser sa satisfaction). L'individu prend en compte
l'évolution dans le temps de ses ressources pour décider d'emprunter ou
d'épargner. Lorsqu’il est jeune il a peu de ressources, il en à l’âge
adulte, et moins lorsqu'il est à la retraite. S'il veut avoir une
consommation régulière, voire légèrement croissante il empruntera
durant sa jeunesse, épargnera dans la force de l’âge et désépargnera à
la fin de sa vie, de sorte qu’en moyenne son patrimoine sera nul à sa
mort. Sa consommation sera, elle, relativement constante. Contrairement
aux indications de Keynes la consommation n'est pas proportionnelle au
revenu.