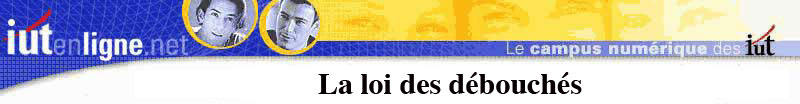
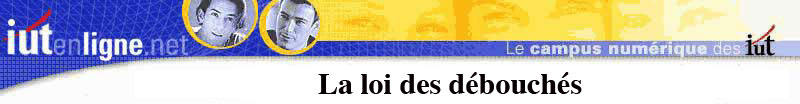
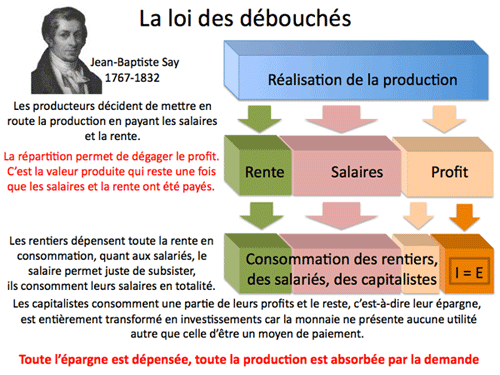 |
Pour les économistes classiques, puisque le salaire est un salaire de subsistance les salariés ne peuvent pas épargner. Les propriétaires fonciers sont supposés dépenser l’essentiel des rentes en consommation improductive. L’épargne ne peut donc être le fait que des capitalistes qui renoncent à consommer la totalité de leurs profits. Cette épargne sera entièrement transformée en investissement et permettra d’élargir la production sans qu'il puisse y avoir un problème de débouchés. C’est Jean-Baptiste Say qui au début du XIXe siècle posera de manière claire la loi dite loi des débouchés. Cette loi est fondée sur une conception simple de la monnaie. La monnaie ne saurait être recherchée pour elle même. Lorsque le capitaliste épargne, il utilise cette épargne dans sa propre affaire (autofinancement) ou en prêtant à un autre capitaliste qui veut investir. Ainsi le revenu créé par la vente de la production est entièrement dépensé, par les salariés, les propriétaires et les capitalistes. L’offre crée sa propre demande. |
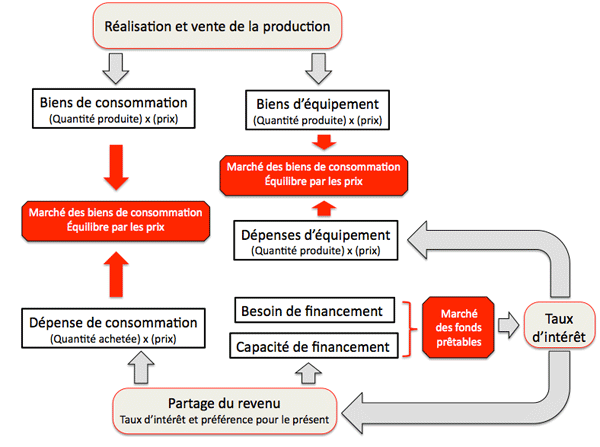 |
Plus tard les économistes néoclassiques exprimeront cette loi en faisant du taux d'intérêt le prix d'équilibre entre épargne et investissements. Puisque la monnaie n'est pas recherchée pour elle même l'épargne doit forcément être consacrée à l'achat de biens d'équipement. Ceux qui disposent d'une épargne (capacité de financemen) rencontrent ceux qui veulent investir et n'en ont pas les moyens (besoins de financement) et la variation du taux d'intérêt rapproche les uns et les autres. Toute l'épargne se transforme en investissement. |